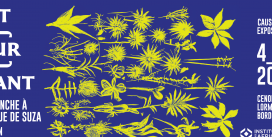Au sommet de cette nouvelle ère de l’image, le tatouage et le piercing ont bonne presse auprès de la jeunesse. Nous assistons à une véritable popularisation de ces pratiques. Elles étaient pourtant jadis réservées en Occident aux personnes en marge de la société tels que les punks, les prisonniers, les prostituées, les marins. Depuis leur réapparition dans les années 70 avec les hippies et leur démocratisation dans les années 90 avec les défilés de haute couture, le corps devient alors un accessoire de mode, un médiateur artistique.
Au sommet de cette nouvelle ère de l’image, le tatouage et le piercing ont bonne presse auprès de la jeunesse. Nous assistons à une véritable popularisation de ces pratiques. Elles étaient pourtant jadis réservées en Occident aux personnes en marge de la société tels que les punks, les prisonniers, les prostituées, les marins. Depuis leur réapparition dans les années 70 avec les hippies et leur démocratisation dans les années 90 avec les défilés de haute couture, le corps devient alors un accessoire de mode, un médiateur artistique.
Un mode d’expression
Les modifications corporelles telles que le piercing et le tatouage sont réapparues en France aux alentours du 18è siècle, rapportés par les marins et navigateurs en guise de souvenir de leur voyage du Pacifique Sud. Il est vrai que ces pratiques étaient jusqu’à présent réservées aux marginaux, tels que les Punks, souhaitant notifier de manière visible leur refus d’adhérer à la société, et elles suscitaient par conséquent rejets et préjugés.
Aujourd’hui, la fascination que le « body art » procure chez les jeunes, malgré les risques et inconvénients, résulte de l’incroyable outil d’expression qu’il constitue. Il permet de devenir son propre créateur (avec son propre corps comme support, on devient une œuvre vivante), de commémorer un évènement important ou une période traumatique surmontée (deuil, adolescence, anniversaire, réussite d’un examen, etc.). C’est parfois un acte thérapeutique. Un perçage ou un tatouage nécessite une période de guérison pour cicatriser d’une durée variable (de quelques jours à quelques semaines). Cela oblige le sujet à porter une attention toute particulière sur soi, sur son corps.
Un mode de punition
Les écrits retrouvés sur ce sujet témoignent du caractère psychopathologique, et discriminatoire du piercing et du tatouage. Ils apparaissent comme une automutilation et la douleur comme une catharsis perverse.
Il existait une fonction punitive du tatouage : un voleur pouvait être condamné à se faire tatouer, et à endurer la douleur que cela procure.
Cette vision péjorative du tatouage se retrouve dans l’histoire chez les Romains qui marquaient, comme on peut marquer le bétail, les soldats de légion, de même que les esclaves et les criminels. Les esclaves étaient également tatoués en Grèce avec le nom du maître.
En 720 av JC, au Japon, un chef de rébellion a été condamné par tatouage, ce qui représentait un signe de honte. Ce mode punitif avait pour but de marquer le sujet à vie. Ce dernier était banni et sa famille exclue de la société. C’est le début d’une longue épopée vers la vision négative du tatouage. Par la suite, son usage fut réservé aux exclus, aux prostituées (Geishas), aux criminels, aux gangs.
Les piercings génitaux ont, dans l’histoire, deux inclinaisons : une prétention érotique censée améliorer ou pimenter les relations intimes (présence en Inde du piercing dans le Kama Sutra) et une vocation punitive voire humiliante destinée à éviter ces mêmes relations (piercing du pénis munis d’un cadenas chez les esclaves romains).
On garde en mémoire certains directeurs d’école qui refoulaient des élèves percés sur le visage et la réticence de quelques employeurs à embaucher des jeunes pratiquant le « body art ».
Cependant, ces pratiques ont été vraiment démocratisées à partir des années 90, par le biais de « peoples » telle que Madonna. On se souvient aussi de Jean-Paul Gauthier, qui avait défrayé la chronique en organisant le premier défilé de mode avec des mannequins percées et tatouées.
Un rite de passage
Aujourd’hui, ces pratiques sont de plus en plus usitées et génèrent un engouement indéniable, en particulier chez les adolescents et les étudiants. A l’ère du dictat de l’image, de la beauté, de la plastique et du paraître, le tatouage et le piercing permettent d’exister au travers de ce que l’on montre, d’utiliser son corps comme un accessoire modelable à l’infini, afin de correspondre au mieux à un idéal personnalisé de la beauté, de l’esthétisme, de la séduction, toute couche sociale confondue.
Les modifications corporelles permettent aux jeunes de se réapproprier l’image de soi, en créant un soi cohérent, un équilibre entre le « vu du dedans » et le « vu de l’extérieur ». L’art corporel est aussi un médiateur. Outre l’effet de mode ou la volonté d’appartenance à un groupe, il constitue l’autocréation d’un rite de passage balisé par des marques visibles, ce qui constitue une archive de soi, et la douleur n’est que la conséquence de cette démarche personnelle. Mais cette notion de rituel initiatique n’est pas une nouveauté. On la retrouve chez de nombreux peuples.
En Amérique centrale, le piercing au téton était exclusivement réservé aux hommes, et témoignait d’un rite de passage à l’âge d’adulte.
En Nouvelle–Zélande, les Maoris pratiquaient le tatouage facial lors d’une cérémonie traditionnelle symbolisant le passage de l’état d’enfant à celui d’adulte. Ce tatouage particulier, appelé « Moko » est pratiqué par des artisans tatoueurs appelés « Tohunga-ta-oko ». Ils utilisaient comme instrument un ciseau en os. Son utilisation rendait l’acte particulièrement douloureux, provoquant souvent un boursouflement provisoire du visage, la douleur éprouvant le courage de l’initié. Il symbolisait ainsi la force et la virilité. Un homme dont le visage est intact est mal vu dans cette société et est considéré comme efféminé. Chez les guerriers, il est un symbole sexuel évident.
En Nouvelle Guinée, les Papous se trouaient la cloison nasale afin d’y introduire des bijoux en os, et plus rarement en bois. Cette pratique avait pour but de créer un lien spirituel avec les animaux dont provenaient les os. Réservée aux hommes et pratiquée lors d’une cérémonie de rite de passage à l’âge adulte, elle servait également à impressionner les femmes.
Chez les Yakusas, apparentés à la mafia japonaise, chaque membre subi un rituel initiatique qui utilise, entre autres, le tatouage. La douleur provoquée par cette pratique est supposée mettre en exergue le courage de l’initié, et de part la permanence du dessin, sa loyauté au clan. Ces rites initiatiques sont exercés tel un art à part entière par des grands maîtres tatoueurs.
Finalement l’histoire prouve que les arts corporels existent depuis toujours puisque le premier tatouage a été découvert depuis la période néolithique. Leurs rôles dans l’histoire sont divers : ils pouvaient être prophylactique, thérapeutiques, identitaire ou tout simplement esthétiques, et touchaient tous les peuples. Il serait sans doute simpliste d’expliquer ce phénomène dans nos sociétés actuelles en le cantonnant aux milieux pornographiques, sadomasochistes, fétichistes, etc. Il reste plus généralement, et de manière plus étendu, dans le cadre d’une recherche d’image de beauté et d’individualité. Il est la marque publique et privée d’une véritable identité personnelle. On constate cependant que ce phénomène, dans les sociétés modernes occidentales, tend à s’uniformiser comme si ceux qui le pratiquent partageaient les mêmes occupations, la même conception de la société, les mêmes attentes. Au-delà de ces constatations, le tatouage, le piercing, le « body paint », les implants, et autres relèvent d’une véritable discipline artistique ayant pour support commun le corps.
Marlène Gervais (Afiavimag)