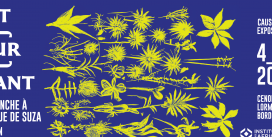Rencontre : PAUL MATHARAN
Lorsqu’on se trouve en présence d’objets d’arts africains traditionnels, qu’il s’agisse de masques, de statues ou de fétiches, on est frappé par deux choses, que l’on soit connaisseur ou pas : l’infini variété de leurs formes et l’incroyable énergie qui s’en dégage. Nous avons là les deux clés de compréhension de ces créations et de ces cultures. En effet ces deux dimensions sont étroitement liées. La richesse des formes reflète une création qui ne cherche pas à imiter le visible mais qui procède souvent par accumulations de formes animales, végétales ou humaines qui constituent autant de réceptacles d’énergies indépendantes qu’il faut se concilier par un système complexe de mise en réseaux, qui constitue ce que l’anthropologue Philippe Descola nomme la pensée analogique.
Si, selon l’expression de Claude Lévi-Strauss « L’objet, c’est de la pensée solidifiée », il devient possible d’approcher cette conception particulière de l’univers en reprenant les différents types de la création traditionnelle africaine.
Prenant l’exemple des masques, on peut partir de l’idée qu’ils sont des objets de « savoir » entre les mains de sociétés initiatiques, de sociétés secrètes ou de confréries. Au point de départ, les masques nous donnent le spectacle du monde et de son fonctionnement. C’est par le masque, par exemple, qu’on raconte les mythes, c’est aussi par lui qu’on dit comment l’homme est arrivé sur terre et comment les sociétés humaines se sont constituées. Il permet d’initier les hommes aux pratiques de la chasse, de la guerre, on l’utilise aussi pour rendre la justice ou pour réordonner le monde dans les temps forts de la vie, par exemple pour accompagner les morts ou fertiliser la terre. Pour approfondir les choses, ce n’est pas le masque lui-même qui agit, mais les énergies qui l’habitent. Le masque ne les représente pas car elles sont par essence immatérielles. On parlera plutôt ici de « présentification ».
D’où vient ce terme de présentification ?
C’est un terme assez compliqué forgé par le célèbre historien et anthropologue français Jean-Pierre Vernant, spécialiste de la Grèce antique et de ses mythes. C’est à propos des masques du théâtre grec qu’il a parlé de « présentification » plutôt que de «représentation»
Le masque dans la Grèce archaïque, n’est pas une représentation figurative réaliste des dieux ou des héros mais plutôt une mise en présence de leurs esprits, donc une présentification. L’imitation proprement dite du réel ne viendra que plus tard.
« Le visible, au lieu d’être la donnée première qu’il s’agirait d’imiter par l’image, prend le sens d’une révélation, précieuse et précaire, d’un invisible qui constitue la réalité fondamentale » Jean- Pierre Vernant.
Car, il y a une ambiguïté sur le terme « représentation ». Il faudrait plutôt parler de « représentants » pour ces objets comme on parlerait de « représentants de commerce » qu’on ne confond en aucun cas avec l’entreprise qu’ils «représentent », mais qui en sont les messagers. Ce qui veut dire que le masque est un outil de contact avec des forces invisibles.
On retrouve le même principe dans la statuaire, laquelle est plutôt orientée vers ce qu’on appelle le culte des ancêtres, c’est-à-dire plus précisément le rapport de « devoir » qu’entretiennent entre eux les vivants et les morts. Car, sans les morts on n’est pas là. Ils sont la continuité de la vie, des lignages, etc. Il faut donc les honorer, leur faire des sacrifices, des libations, des prières. En contrepartie, les morts interviennent dans notre vie pour nous aider pendant les moments difficiles, les épidémies, les famines, les guerres.
Dans la pensée africaine, le monde est perçu comme un continuel chaos, un désordre de forces, ces forces de la nature, ces forces des ancêtres sur lesquelles il faut agir à la fois pour s’en protéger et pour obtenir leur aide, car elles peuvent entrer en contact avec les divinités ou avec Dieu lui-même pour faire en sorte que tout fonctionne normalement.
Il y a donc cette dimension particulière qu’on peut essayer de lire dans l’art africain. Mais cette lecture est difficile car ce langage est ésotérique et se développe au sein de sociétés secrètes. De plus il s’est produit dans le temps une forme d’acculturation avec le passage de la colonisation, du christianisme, de l’islam… une sorte de coupure vis-à-vis du monde des ancêtres.
Ce qui finalement reste peut-être le plus présent aujourd’hui, c’est la magie et l’utilisation des fétiches considérés comme de véritables objets « de pouvoir ». C’est la raison pour laquelle nous commençons notre exposition par une série de photographies récente d’ Agnès Pataud qui s’est régulièrement rendue en Afrique à la rencontre des féticheurs. Elle a discuté avec eux, a photographié leurs sanctuaires, a rapporté leurs paroles dans son livre « Coeur blanc. Ventre blanc ». Cela nous montre que cette pensée est toujours présente et active. Peut-être même que c’est une pensée beaucoup plus subtile et ouverte que la pensée scientifique. Si l’on accorde à la pensée scientifique de meilleurs résultats, la pensée magique est quant à elle, une pensée quasiment philosophique. C’est une vision globalisante du monde qui permet d’aller plus loin que la simple approche scientifique qui aboutit parfois à certaines catastrophes. On le voit en ce moment avec le nucléaire. Merleau-Ponty disait que la science manipule les objets, mais que la magie les habite. Cela veut dire que tous ces fétiches renvoient à quelque chose de profond et d’insondable. Et, je rappelle qu’il y a beaucoup de malentendus autour de ce mot qui vient du portugais et qui veut dire artificiel, factice. Ce sont les portugais qui ont introduit cette notion qui n’a rien à voir avec le factice. C’est tout le contraire. Les fétiches ne sont pas des idoles que l’on adore. Ce sont des moyens de communication et d’action sur le monde. Ils font partie de cette pensée où les forces peuvent être manipulées. Il y a une dimension active dans le fétiche, et ça, c’est d’une grande richesse. Même l’art contemporain, au-delà de la période des cubistes ou des surréalistes, s’intéresse beaucoup à ces œuvres parce qu’il s’agit d’objets en perpétuel renouvellement. Ce que les spécialistes appellent de l’art « accumulatif » ou « processuel » Il y a toujours un processus, car l’objet n’est jamais fini. Et c’est ça qui est tout à fait particulier dans la dynamique du fétiche.
Trouve-t-on dans la société européenne, d’avant la Rationalité, la Renaissance ou les religions monothéistes ce même sens ou cette même pensée analogique ?
Je dirais oui, la conception du monde était la même. C’est-à-dire un monde « enchanté », rempli de fées, d’elfes, d’esprits bons ou mauvais qui habitaient les bois et les sources. La pensée magique était présente dans les campagnes, dans les croyances populaires y compris chrétiennes, chez les sculpteurs de cathédrales qui « mettaient de l’âme » dans leurs personnages de pierre. Après, on peut faire des différences subtiles entre l’animisme, le totémisme, l’analogisme etc. De plus on reconnaît aujourd’hui que cette pensée était non seulement présente avant l’avènement de la science en Occident mais qu’elle est toujours active en chacun d’entre nous, pour la raison bien simple qu’elle s’associée à la condition humaine, à notre situation, c’est-à-dire à la mort. Autrement dit, pour pouvoir vivre, il faut se donner des explications et agir sur les choses. Il y a donc une pensée vraiment commune même si elle peut prendre des formes différentes. Elle est toujours présente chez nous à travers la création artistique, la poésie, la musique. Je pense par exemples aux poètes ou aux peintres symbolistes, Baudelaire et ses correspondances, Odilon Redon et son imaginaire. Le questionnement sur l’invisible est toujours d’actualité y compris chez les scientifiques. Les astrophysiciens travaillent sur la matière noire qui constituerait 23% de notre univers contre 4% seulement de matière visible et 73% d’énergie noire ou force d’expansion de l’univers… On est loin des masques et des fétiches, et pourtant… .
Et par rapport aux danses, aux transes, les masques et les fétiches ont-ils la même importance ?
La transe, la musique, le mouvement, la dynamique, la parole, l’objet, tout cela fait partie du même ensemble. Ils sont liés au fait que les spécialistes, devins ou féticheurs, ont besoin d’être possédé par un esprit, une force. Ils sont eux-mêmes habités par différentes énergies dont ils ont besoin pour être efficaces et mettre en branle l’esprit de l’objet qu’ils doivent manipuler. Il y avait un chef ou un devin en République démocratique du Congo qui répondait à ceux qui l’interrogeaient sur le pouvoir des fétiches « Si vous chargez un objet sans la parole, c’est comme si vous envoyez une lettre sans y coller le timbre ». La parole en Afrique est, peut-être, ce qui est le plus important. C’est pour cela que nous complétons l’exposition d’extraits de films avec des commentaires et des paroles anciennes ou sacrées comme dans le film de Jean Rouch sur les Dogon « Le Dama D’Ambara » qui raconte les cérémonies funéraires accompagnant les morts dans leurs dernières demeures.
N’avez-vous pas l’impression d’avoir enfermé les énergies ?
Je ne sais pas. Je crois quand même que pour réveiller des énergies il faut des spécialistes. Le paradoxe d’un musée, c’est que quand vous y mettez un objet, sans aller jusqu’à parler de cimetière, vous avez l’impression de le sortir du circuit du présent, de le rendre caduque. Selon l’expression bien connue « il est bon pour le musée ». D’un autre côté, il est re-sacralisé d’une autre façon. Dans un musée les gens font attention, ils ne font pas de bruit un peu comme dans une église. C’est le rôle du conservateur de profiter de cette occasion d’attention et de respect, pour faire passer un message sur la culture et la richesse de l’autre.
Si la culture du musée est restée longtemps étrangère à l’Afrique, son rôle d’outil de mémoire commence à être mieux perçu y compris dans les pays africains où la création de musées, de lieux de rencontres, de centres d’interprétations se développe de plus en plus, sans oublier la conservation de la culture immatérielle si importante en Afrique. Et il faut, à mon avis, développer tous les moyens possibles pour ne pas perdre la mémoire des choses. Il ne s’agit pas de revenir en arrière, mais il ne s’agit pas non plus d’oublier le passé. Cela correspond d’ailleurs à la philosophie africaine. Comme le dit si bien Pacere F. Titinga
« Si la branche veut fleurir, qu’elle honore ses racines »
En tant qu’ethnologue, qu’attendez-vous du public à travers cette exposition d’art africain ?
Au départ, on avait envie d’exposer des objets inconnus du public. Des objets invisibles en quelque sorte. C’était une première approche importante, car lorsque l’on ouvre les livres d’arts africains on retrouve souvent les mêmes objets, appartenant aux grands musées et aux grands collectionneurs. On voulait montrer que l’Afrique était beaucoup plus riche que cela.
Mais au-delà de cette démarche, même si les objets présentés sont assez exceptionnels, même s’ils sont des chefs- d’œuvre, il s’agissait surtout de faire prendre conscience au public qu’on peut appréhender le monde différemment, qu’il faut respecter cette différence et reconnaître la complexité de cette pensée. Car on a toujours tendance à faire de l’ethnocentrisme et cela, quelles que soient les cultures auxquelles on appartient. Si on veut avancer, il faut admettre la valeur de l’autre, ce qui est possible par le biais des expositions, par la découverte de la richesse des objets et de leur fonctionnement.
Quand on voit comment ils sont utilisés, on réalise qu’ils renvoient à une forme de solidarité. Le groupe, dans des conditions de vie difficiles, utilise les objets pour se protéger. D’où une entraide collective, mais aussi un respect vis-à-vis de l’environnement et de la nature. Même s’il s’agit d’une solidarité de fait, forcée et qu’il ne faut pas nécessairement rechercher une dimension morale derrière, il n’empêche qu’avec cette pensée, la nature est respectée. Par exemple, traditionnellement, vous n’allez pas couper un arbre ou tuer un animal sans faire des rituels appropriés. L’homme ne doit pas s’autoriser à faire n’importe quoi. C’est une question de bon sens, d’équilibre et de survie et c’est le message que nous souhaitions faire passer au public.
A. D’Almeida (AFIAVImag) N°11