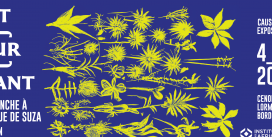C’est bien en parlant de la poésie que le poète Paul Verlaine recommandait « de la musique avant toute chose ». La littérature emprunte donc à la musique. Or, à l’image de la littérature, beaucoup de musiques racontent une histoire, mais elles le font avec une grammaire particulière et un lexique sonore de mélodies, de chants et d’harmonies. Musique et littérature vont souvent ensemble. Ce sont deux passagers de la même pirogue qui s’arrête aux ports de la sociologie, de l’Histoire et de la création artistique. Pourquoi ne pas suivre le vagabondage de cette pirogue à travers les littératures afro-caraibéennes ?
Musique, mode d’emploi
Jacques Attali montre dans Bruits (1977) comment la musique respire l’âme d’une société et répercute les moindres événements de son histoire. La littérature partage avec la musique de nombreux territoires, mais aussi des techniques et des objectifs. Toutes les deux cultivent le souci de la construction et une stratégie de séduction. L’écrivain est particulièrement sensible au rythme, à l’harmonie et à la composition, qui relèvent du domaine musical. Il compose des chants épiques, ou des chants lyriques, comme les Chants d’Ombre (1945) de Léopold Senghor, il construit de véritables polyphonies et des romans symphoniques. Il utilise la technique du contrepoint comme l’Anglais Aldous Huxley, celle du concerto, comme le Cubain Alejo Carpentier (Concert baroque, 1974) ou celle des percussions gwoka comme le poète guadeloupéen Max Rippon. Il faut associer au pouvoir de suggestion de la musique le riche potentiel d’évocation de la danse . On comprend que beaucoup d’auteurs en exploitent la richesse significative dans le choix de leurs titres : le Nigérian Wole Soyinka, La Danse de la forêt (A Dance of thé Forests, 1963), Alejo Carpentier, La Danse sacrale (La Consagracion de la Primavera, 1980J, le Togolais Kossi Efoui, Indépendance cha cha cha sur fond de blues (1992) et La Polka, le Guadeloupéen Ernest Pépin, Le Tango de la haine (1999) ou le Martiniquais Roland Brival dans Biguine Blues (1999). Signalons aussi le cas d’auteurs, comme le Camerounais Francis Bebey, qui sont à la fois musiciens professionnels et écrivains.
La manière dont la musique est insérée dans la trame de l’œuvre littéraire varie suivant les choix d’écriture des écrivains. Nous retiendrons trois modes d’insertion : la musique témoin de l’histoire, la musique fonctionnant comme structure organisatrice, et la musique comme source de métaphores.
Les modulations de l’Histoire
Dans l’histoire du Monde Noir, la violence de l’esclavage, prolongée par celle de la colonisation et de nombreuses dictatures postcoloniales, a suscité dans la littérature une dynamique de résistance, de réécriture et de réhabilitation. Dans Tambour-Babel (1996) du Quadeloupéen Ernest Pépin, c’est le tambour du gwoka qui raconte la terrible histoire d’arrachement à la terre africaine et de réenracinement héroïque dans les terres du Nouveau Monde. D’abord, avertit le narrateur, « on ne manie pas à la légère un instrument aussi chargé de souffrance. (1). La parole du tambour a enregistré tous les bruits de l’épopée agricole et anonyme du peuple des transplantés : « Les tambours(…) imitaient les craquements du bâtiment, les grincements des cordages, les hurlements du fouet, grageaient le manioc, fouillaient les fosses d’igname, damaient la terre, dépaillaient les cannes, rassemblaient l’attelage des corps disloqués, (…) ajoutaient des nœuds à la mémoire (…) et créaient une langue pour remplacer toutes les langues perdues. Tambour-Babel ! (2) La terrible opération Babel organisée par le colonisateur, celle de la confusion des langues et du brouillage de la communication par le mélange systématique des ethnies, cette
opération a été neutralisée par la puissance des tambours Ka : « Le Ka calcule la souffrance, le Ka ne capitule pas, il caracole en tête de toutes les révoltes ». (3) La musique représente ici la puissance de survie qui permet de résister à la déshumanisa-tion esclavagiste et de reconstruire une nouvelle identité. Mais lorsque la déshumanisation est pratiquée par des dirigeants internes au Monde Noir, on a affaire non à une résistance épique contre un ennemi extérieur, mais à un combat tragique contre la trahison des proches. La musique symbolise encore la résistance, mais sa vigueur dynamique est assombrie par le soleil noir de la désillusion. Dans l’Afrique des années 80, la mise en scène de nombreux régimes absolutistes déguisés en républiques a donné lieu à une littérature de la dérision et de la dissonance. La fête rêvée de la liberté retrouvée s’est transformée en cauchemar dans les « Etats honteux » (S. Labou Tansi) issus du moule colonial. L’une des métaphores obsessionnelles de cette décennie est celle du bal tragique (4), que l’on retrouvera dans plusieurs titres : Le Bal des caïmans, (1980) du Camerounais Yodi Carone, Le Bal de Ndinga, (1987) du Congolais Thicaya U Tarn Si, Le Bal des fous (1989) du Togolais Selom Gbanou. Ndinga est cireur de parquet dans un hôtel qui est un « bordel six étoiles » dirigé par un patron européen douteux acoquiné avec un militaire africain inquiétant, le sergent Ntubuma. Ndinga danse beaucoup, grisé par l’euphorie de la proximité de l’indépendance, mais il meurt atteint par une balle, précisément le jour de l’indépendance. Dans Le Bal des fous, la musique lancinante que l’on entend est celle du bruit des bottes militaires qui composent un refrain grinçant. La Tortue qui chante (1987) du Togolais Sénouvo Agbota Zinsou est une pièce de théâtre que l’on peut voir comme une fable sur le pouvoir, car l’animal magique (la tortue qui chante, rencontrée dans la forêt) devient un lieu vers lequel convergent appétits et convoitises découlant en somme de la volonté de puissance qui introduit le chaos dans les relations familiales, sociales et politiques. Dans les œuvres mentionnées ici, l’on est confronté à une fête pervertie. La musique, symbole d’épanouissement devrait investir les rêves d’espoir, mais le symbole est piégé, dégradé, transformé par une alchimie de la cruauté.
L’architecture musicale
Certains auteurs transfèrent à l’œuvre littéraire les procédés de construction de l’œuvre musicale, ou tentent de recréer par les sonorités verbales un paysage musical.
En ce qui concerne ce que nous appellerons les romans sympho-niques. l’exemple le plus édifiant est représenté par l’oeuvre du romancier cubain Alejo Carpentier qui dès son premier roman Ecue-Yamba-O (1933) nous fait part de sa fascination pour « l’échafaudage du rythme » et pour « la palpitante architecture des sons ». (5)A. Carpentier, dont le père était architecte et excellent violoncelliste, écrivit une histoire de la musique cubaine, La Musica en Cuba (1946) et rédigea de nombreuses chroniques musicales. Son roman intitulé La Chasse à l’homme (El Acoso, 1955) est construit comme une sonate, et son dernier roman, La Danse sacrale (La Consagracion de la Primavera, 1980) la découverte de la danse afro-cubaine amène la danseuse Vera à percevoir différemment Le Sacre du Printemps de Stravinski. Il faudrait mentionner avant Alejo Carpentier l’aventure musico-lit-téraire du poète cubain Nicolas Guillén qui utilisa abondamment le schéma rythmique du son cubain pour exprimer le vécu transfiguré de personnages issus des couches populaires. Le terme son apparaît dans les titres de plusieurs recueils de poèmes de Guillén : Motivos de son (1930), Songoro Cosongo (1931), Cantos para Soldados y Sones para Turistas (1937), El Son Entero (1947). Tout un courant de la poésie latino-américaine, notamment caraïbéenne, a exploité la musicalité des mots à consonance africaine afin de créer un paysage ou un dépaysement sonore chaleureux. Ce mouvement s’est développé notamment dans les années de l’Entre-deux-Guerres où l’on assiste, grâce, en partie, à la légitime contre-attaque menée par la Négritude, à une prise en compte des éléments culturels noirs dans plusieurs pays latino-américains. Cette prise en compte, favorisée par des travaux d’anthropologues, ne signifie pas pour autant une meilleure intégration des populations noires dans les sociétés métissées des Amériques. Il s’agit souvent de la récupération esthétique des musiques afro-américaines, suivant des démarches qui oscillent entre la passion intégrationniste (Nicolas Guillén, A. Carpentier) et le recours au pittoresque de l’exotisme socioculturel. En ce qui concerne la littérature africaine, on retrouve la musique comme faisant partie intégrante d’un théâtre total, non comme simple artifice d’ornement, mais comme élément constitutif important, chargée de fonctions multiples : pause respiratoire, fonction référentielle, rôle d’amplification des messages, support d’évocation des mythes (Chez Soyinka) etc… La danse est une composante normale de certaines formes de théâtre populaire comme le concert party au Ghana et au Togo.
La musique : une forêt de symboles
Parmi les très nombreuses significations émanant de la musique, nous choisirons deux tendances importantes : la musique incarnant la magie, l’enchantement, le rêve, et la musique
symbolisant la tradition confrontée à la modernité. C’est par sa dimension immatérielle que la musique investit notre imaginaire. Elle est associée à l’énergie créatrice, à l’émerveillement, à l’extase et à la transe mystique. Dans Les Arbres musiciens (1957) de l’Haïtien Jacques Alexis, le chant de la forêt est à la fois intemporel et invulnérable. Le Congolais Emmanuel Dongala nous montre, dans Jazz et vin de palme (1982) comment des extraterrestres eux-mêmes cèdent à la magie du jazz : « Tout d’un coup, de partout, des maisons, de l’intérieur de la Terre, de l’Espace, éclatèrent les sonorités envoûtantes du saxophone
de John Coltrane. Et les créatures de balancer la tête, les yeux comme figés ; bientôt sur des centaines de kilomètres carrés, il n’y avait que des corps en transes pris dans une gigantesque danse de possession ». (6) Et le récit se termine par cette phrase : « Et c’est ainsi, enfin, que le jazz conquit le monde ». (7) Ancrée dans l’histoire de l’Afrique-Caraïbes, la musique est souvent indissociable du monde de la tradition, qu’il s’agisse d’un univers à protéger, ou d’un passé qu’il faut savoir lire en fonction d’un avenir à construire. Dans Le Chant du Lac (1965) du Béninois Olympe Bhély-Quenum, le chant des monstres du lac est comme un chant de sirène angoissante, qui représente une tradition étouffante par certains aspects. Les monstres « n’étaient que des boas lacustres à tête de chien, tout en gueule et puant comme des cadavres en putréfaction ». (8) Avoir affaire à eux, pour le personnage Mme Ounéhou, c’était découvrir « une révélation et une désillusion ». (9)Le poids de certaines traditions est un handicap dans l’aventure promé-théenne de la maîtrise du progrès ; d’où la formule de Mme Ounéhou : « Le mystère mais pas la terreur ». (10 )La Danse de la Forêt de Wole Soyinka est la fête organisée par les dieux mécontents de l’accueil que leur font les hommes à l’occasion d’une fête qu’ils font pour célébrer l’Indépendance. Cette fête des dieux est le lieu d’une lecture critique des rapports entre modernité et tradition. Nous avons vu quelques aspects des rapports entre musique et littérature dans le monde afro-caraïbéen. Musique et littérature, deux passagers d’une même pirogue, que nous avons suivi quelques instants dans un voyage qui n’a pas de fin.