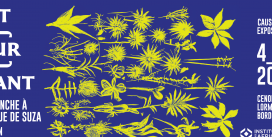Quitter sa famille, ses amis, son village, son pays pour s’installer ailleurs est toujours une rupture. Peu ou prou, elle bouscule les frontières des identités individuelles et collectives. C’est, dans un premier temps du moins, affronter l’insécurité des lieux inconnus, des lieux à inventer afin de vaincre la solitude qui menace toute migration. Gens d’ici, gens d’ailleurs, gens de nulle part, les risques sont nombreux. Pour autant, si l’on interroge les différents flux migratoires, on est frappé par la plasticité des identités, la multiplicité des inventions requises pour donner sens au déplacement. C’est le cas notamment des associations de femmes africaines qui s’inscrivent dans cette volonté de répondre aux questions que posent des situations incertaines. Depuis quinze ans maintenant, elles ne cessent de se multiplier dans les quartiers, de se diversifier quant à leur vocation et leur composition.
Dans les années quatre-vingt, la situation qui préside à l’installation des femmes qui arrivent en France est une situation de crise. Elles ont rompu avec le système d’affiliation et de solidarité en vigueur dans leur propre société et doivent réinventer le sens social de leur présence en France, c’est-à-dire le sens qu’elles peuvent trouver à leurs relations aux autres en tant qu’étrangères. La tâche est d’autant plus difficile que la société d’accueil est peu préparée. La pénurie de logements sociaux, aggravée par des attitudes discriminatoires de la part de bailleurs sociaux et privés, se traduit par de très fortes concentrations de familles africaines dans des habitats vétustes, exigus, aussi bien à Paris qu’en banlieue. Cette situation locative pèse essentiellement sur les femmes à qui incombe la totalité de la gestion de l’espace domestique. Dans le même temps, elles ont à résoudre les problèmes que leur pose l’insertion familiale dans la cité : voisinage, école, multiples sollicitations des différentes structures et institutions administratives, sociales ou médicales. Elles se retrouvent au centre de toutes les questions suscitées par la conquête de leur propre place dans l’espace public. Enfin, le projet migratoire des femmes comprend la nécessité d’avoir accès à des revenus pécuniaires. Or la situation de l’emploi leur est d’autant moins favorable que beaucoup d’entre elles ne possèdent pas les caractéristiques requises par un marché du travail où sévit un fort taux de chômage.
Dans une société où le travail salarié est la base de la reconnaissance sociale et le socle auquel s’attachent les protections contre l’insécurité et le malheur, la difficulté d’une insertion par le travail salarié n’est pas des moindres. Elle constitue à n’en pas douter un obstacle fondamental à la réinvention du lien social pourtant nécessaire, sauf à se mettre dans l’exclusion ou la réclusion totale.
Ni les institutions, ni les communautés, ni les familles ne sont prêtes, en leur état, à répondre aux nouvelles exigences face auxquelles les femmes sont confrontées.
Les partenaires sociaux qui ont eu charge de l’intégration au quotidien se trouvent confrontés à une contradiction d’importance. D’un côté, ils ont pour mission de faire respecter un modèle, l’ensemble des lois, des valeurs et des comportements par lesquels il se traduit ; de l’autre, ils s’adressent à une population qui ne bénéficie pas des conditions sociales qui leur permettraient d’adhérer à ce modèle, et qui estime préserver son identité, pourtant en transition par la force même de sa situation de migration, en reproduisant au plus près le système qu’elle a quitté. Il s’agit de mettre en relief les éléments de négociations possibles, les points de passage entre ces deux logiques dont l’une comme l’autre, à être menées séparément, risquent d’accroître les processus de ségrégation, de négation de l’Autre, d’enfermement.
Mar Fall (Afiavimag)