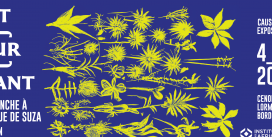En plus d’une exposition permanente consacrée à l’histoire de l’esclavage et des Traites, le musée d’Aquitaine expose spécialement sur l’art africain. Il s’agit d’une démarche pédagogique pour faire comprendre à son public un type d’art qui repose essentiellement sur « l’au-delà des choses », le monde invisible. François Hubert, ex directeur et conservateur dudit musée l’explique clairement dans cet entretien. En outre, il précise que l’autre objectif de cette exposition est le souci du musée d’impliquer et de raconter l’histoire des citoyens d’origine africaine et antillaise.
En plus d’une exposition permanente consacrée à l’histoire de l’esclavage et des Traites, le musée d’Aquitaine expose spécialement sur l’art africain. Il s’agit d’une démarche pédagogique pour faire comprendre à son public un type d’art qui repose essentiellement sur « l’au-delà des choses », le monde invisible. François Hubert, ex directeur et conservateur dudit musée l’explique clairement dans cet entretien. En outre, il précise que l’autre objectif de cette exposition est le souci du musée d’impliquer et de raconter l’histoire des citoyens d’origine africaine et antillaise.
Afiavi : Pourquoi cette exposition spécialement africaine ?
François Hubert : Le musée d’Aquitaine a, depuis toujours, des collections africaines et même océaniennes liées à l’histoire de Bordeaux. Au 18e et 19e siècle des marins, des armateurs, des explorateurs allaient un peu partout dans le monde et revenaient à Bordeaux avec beaucoup d’objets dont la plupart sont arrivés dans ce musée. Sous la houlette de Paul Matharan, le musée organisait dans les années 90 de grandes expositions sur l’Afrique. Celles-ci ont marqué les gens puisqu’ils s’en souviennent encore. Il y en avait d’ailleurs une sur le Gabon et une autre sur la Mauritanie. Et puis, on est passé à des thèmes plus bordelais ou régionaux. Mais à partir de 2005 on a commencé à réfléchir sur un nouveau projet scientifique et culturel axé non plus sur la région mais sur les relations de Bordeaux avec le reste du monde au fil du temps et de l’histoire. C’est dans ce cadre qu’on a ouvert entre autre, en 2009, de nouvelles salles (permanentes) intitulées « Bordeaux, le commerce atlantique et l’esclavage ». Elles ont pour vocation de montrer la place de Bordeaux dans cette histoire tragique de la traite des Noirs, dans une économie fondée sur l’esclavage et sur des plantations aux Antilles, notamment. Dans cette logique, puisque c’est un sujet qui a tant passionné les gens, on continue par des expositions temporaires à étudier la question des relations avec les autres pays. Donc c’est l’Afrique parce qu’on avait des collections sur elle. C’est aussi parce qu’il y a d’autres musées (comme celui du Quai Branly) ayant des collections mais qui travaillent sur ces sujets avec des approches plus esthétisantes. Ils présentent les objets comme des objets d’art simplement. Or nous, nous partons de l’idée que l’on présente aujourd’hui les objets africains comme des objets d’art derrière lesquels il y a une vision du monde et une spiritualité différentes des nôtres. Avec cette exposition, Paul Matharan a voulu faire comprendre au public bordelais et aux visiteurs en général que l’art africain est très différent de l’art européen non pas seulement par sa forme mais aussi dans ce qu’il signifie et ce à quoi il renvoie. C’est en cela que notre démarche est originale et nouvelle. L’autre aspect nouveau c’est qu’en réalité il y a beaucoup d’objets venus de notre propre collection, quelques-unes du Quai Branly et d’autres grands musées européens ceux de Neuchâtel en Suisse et de Tervuren en Belgique. De même, beaucoup d’autres nous viennent de collectionneurs privés en Français et Belges. Mais le double intérêt de cette exposition c’est d’abord l’originalité des objets et leur signification pour les cultures africaines.
N’y a-t’ il pas un risque d’isoler des objets d’art de leurs origines. Les gens comprendront-ils leur sens authentique ?
- H: C’est toujours une difficulté de savoir si les gens comprennent ce qu’il y a derrière les objets qu’on montre. Aujourd’hui il y a un tel engouement que beaucoup de visiteurs viennent non seulement parce que ces arts sont beaux mais aussi parce qu’ils ne les connaissent ni ne les voient dans d’autres expositions. Cet intérêt fait que l’art aujourd’hui est un marché et que l’art africain en particulier coûte cher. D’ailleurs, des riches européens sont les seuls à pouvoir en acheter. Même les musées ont des difficultés pour s’en procurer et cela explique notre obligation de travailler avec des collectionneurs privés dans des expositions comme celle-ci. Mais on essaie tout de même d’expliquer cette dimension anthropologique, humaine, spirituelle… cachée derrière cet art. Ce que je trouve intéressant dans la démarche de Matharan et ses collègues, c’est le fait qu’il ne s’agisse pas de l’art comme expression d’une spiritualité d’une époque, du 18e, du 19e ou du 20e siècle, mais la perpétuité des cultures africaines véhiculées. Tout le début de l’exposition est une exposition de photographie faite par une parisienne très compétente du nom d’Agnès Pataux (très bonne photographe) qui va très souvent en Afrique. Elle y montre que des gens perpétuent cette tradition d’intercession entre l’ici et l’au-delà. Autrement dit, des devins continuent encore toute cette spiritualité en Afrique. Nous montrons ainsi l’existence de cette richesse, spiritualité et spécificité africaines par la photographie dans son aspect contemporain.
Qu’est-ce que donc cette spiritualité africaine ?
- H : Bonne question. Je crois que Paul Matharan est la personne la mieux indiquée pour y répondre. C’est le grand spécialiste de cette exposition qui pourra mieux vous l’expliquer. Mais à ma connaissance, c’est que l’art dans notre monde européen renvoie à des représentations du monde tel qu’il est y compris en l’embellissant. Cependant l’art africain, à mon avis, ne cherche pas à représenter le monde, mais ce qu’il y a au-delà. Il renvoie à ce qui est au-dessus du monde, qui l’a fondé, qui agit sur lui et interagit avec nous. C’est toute cette dimension qu’il essaie de mettre en évidence. Mais je crois vraiment que c’est Paul Matharan qu’il faut interroger.
Vous consacrez une salle de mémoire sur l’esclavage dans ce musée alors que la ville a peiné à reconnaître sa place dans ce commerce tragique. Quelles en sont les raisons ?
- H : D’abord ce n’est pas qu’une salle. C’est quand même quatre qui racontent l’histoire de Bordeaux, du commerce des esclaves, de la traite des Noirs et de la place que la ville a joué. Vous parlez de salle mémorielle mais moi je défends l’idée que d’une salle historique. Ce n’est pas une salle de mémoire car ce n’est pas un lieu de recueillement. C’est un lieu de compréhension et d’explication de cette histoire. A ce sujet, il faut savoir qu’on a pu ouvrir ces salles pour plusieurs raisons. Je vais vous en évoquer deux. D’abord il y a eu des attentes très fortes voire même des revendications de la part d’associations créées par des gens d’origine antillaise ou africaine qui ne comprenaient pas pourquoi Bordeaux n’évoquait pas cette histoire. Cela a amené les élus à prendre compte du problème et à proposer que le musée puisse raconter cette histoire. Car une exposition permanente de cette envergure, c’est-à-dire sur 700m² coûte quand des sous et a nécessité une avale politique. Ensuite, l’autre raison qui est plus compliquée, c’est le problème des musées en termes de traces matériels. Comme vous le savez bien, les esclaves ne possédaient rien. Il est donc difficile de montrer la vie de gens qui n’avaient rien. Cependant, nous avons eu la chance en 2000 de bénéficier de ce qu’on a appelé le legs Chatillon. Monsieur Chatillon était un médecin et exerçait toute sa vie durant aux Antilles, plus particulièrement en Guyane et en Guadeloupe. Il avait collectionné des représentations et des images sur l’histoire de ces îles du 16e au 20e siècle. A sa mort, il nous a légués 600 tableaux, gravures et peintures de sa collection. Si on a pu réaliser cette collection après 2000 c’est qu’on n’avait pas d’œuvres faisant office de témoignages concrets, visuels permettant de comprendre les conditions de vie de ces esclavages à travers un musée. Vous savez aussi que ce musée comme ceux qui ont ouvert leurs portes à la fin des années 80 en France avait une vocation régionale. Ils traitaient de la région, des cultures régionales et des identités régionales. Il visait, comme tous les autres musées d’histoire et d’ethnographie (le musée de Normandie à Caen ou du musée de Bretagne à Rennes) à présenter les spécifiés des identités régionales. Et puis, petit à petit, ces salles n’ont plus intéressé le public comme si les questions d’identités régionales avaient été réglées. Mais avec les questions de la mondialisation, de l’immigration, tout ce qui surgit dans le débat actuel à Bordeaux comme dans d’autres villes, c’est aussi l’histoire des populations d’origines africaine et antillaise qu’il s’agit de traiter. Il y a eu des demandes d’éclaircissements de ces histoires douloureuses. On a donc ouvert ces salles parce que les musés ne sont pas extensibles. Car, avant il n’y avait qu’une seule petite salle inférieure à 100m² qui était consacrée à la totalité du 18e siècle avec quelques gravures sur l’esclavage. Maintenant on est à 4 salles de 750m² dédiées à l’esclavage et aux Traites grâce au démontage de salles jadis consacrées à l’ethnographie régionale. Cela est important et signifie que les musés servent à répondre aux questions que les gens se posent à un moment donné. Depuis une dizaine ou une quinzaine d’années on a vu qu’on se posait des questions sur l’esclavage et maintenant on tente d’y répondre. Et quand on lit les cahiers des visiteurs, on se rend compte que les avis donnés par le public correspondent bien à ses attentes. En plus, on constate que des gens d’origine africaine ou antillaise viennent visiter le misée alors qu’ils ne le faisaient pas avant. Cela veut dire qu’ils considèrent que leur histoire est intégrée au musée de la ville de Bordeaux et ils en font leur.
Quel bilan tirez-vous de toute cette nouvelle exposition ?
- H : On part de l’analyse des cahiers mis à la disposition du public pour voir les critiques positives et négatives qui sont émises. Mais au total on sait que le bilan est positif parce que comme je vous l’ai dit tantôt, on voit des gens qui ne venaient pas au musée, conscients de leur histoire, se réjouir de savoir que celle-ci est intégrée dans une réflexion globale sur l’histoire de l’Aquitaine. Ainsi, quand on parle de musée d’Aquitaine on ne pense pas seulement aux populations installées dans cette région depuis 3 mille ans mais aussi aux nouvelles populations arrivées plus récemment et qui s’impliquent dans le développement de la ville de Bordeaux et de la région aquitaine.
Que répondez-vous aux critiques relatives à la non pertinence de mettre l’art africain dans un musée ?
- H : C’est un peu vrai de dire que l’art africain a une forte signification au point que se pose la question de la pertinence de le déplacer de son lieu originel vers un musée. C’est vrai que c’est une notion de charge qui est en jeu. A l’intérieur des statuts il y a de la charge qui renvoie à des puissances existant au-delà de nous. Et donc certaines personnes ont des craintes et se demandant comment on peut regrouper tous ces objets dans un musée. Car il y a tellement de charge, tellement d’énergie diffusée qu’ils se sentent mal dans des environnements comme le musée. C’est une question intéressante que de penser que ces objets ont plus à faire dans la nature qu’ailleurs. Cependant notre démarche est d’expliquer les dimensions historique et anthropologique. Et on va voir comment cela va se passer. D’ailleurs un débat important est né, celui de savoir pourquoi tous ces objets sont maintenant en Europe. Car tous les objets que nous présentons ici en Europe viennent d’Afrique. On a des collections qui viennent toutes d’Afrique. Seulement, ils sont collectionnés par des Européens. Il y a certes quelques collections qui sont l’œuvre d’Africains. Mais pour l’homme africain à la différence de l’homme européen, ce n’est pas le côté matériel qui est important mais le côté spirituel.
Propos recueillis par
Patrice CORREA
Augustin D’Almeida
et Paul Moffen